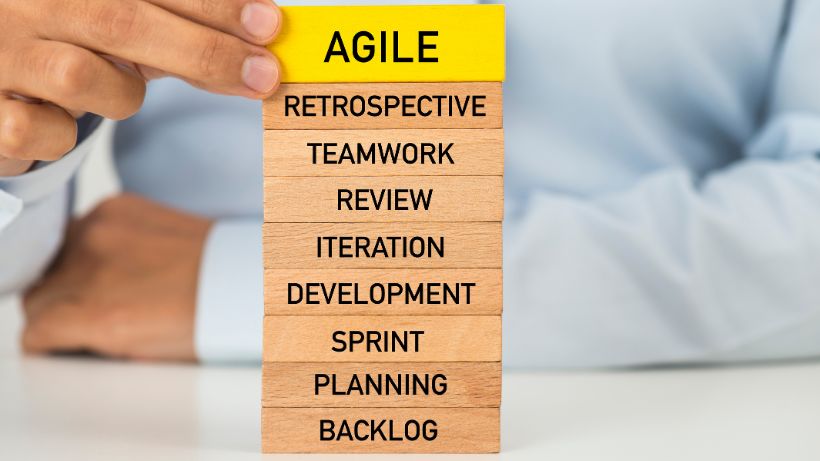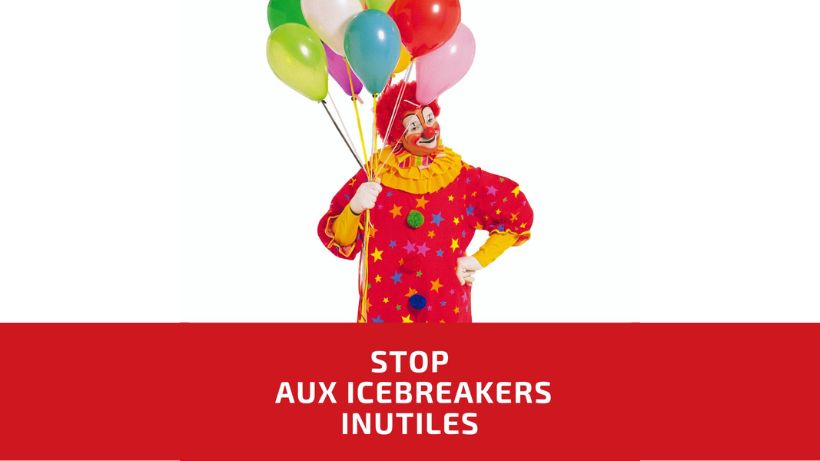Nous vivons une époque marquée par des défis globaux, complexes, et interconnectés : changement climatique, effondrement de la biodiversité, tensions sociales, crise du travail, perte de repères éducatifs… Ces transformations systémiques appellent des réponses nouvelles. Or, aucune discipline, aucune organisation, aucun individu seul ne peut y répondre de façon satisfaisante.
Ce constat pousse de plus en plus d’acteurs – institutions, associations, entreprises, collectivités, collectifs citoyens – à miser sur un autre levier : la capacité d’un groupe à produire ensemble des diagnostics partagés, des visions communes, et des solutions concrètes. Cette capacité, on l’appelle intelligence collective.
« L’intelligence collective est une intelligence partout distribuée, sans cesse valorisée, coordonnée en temps réel, qui aboutit à une mobilisation effective des compétences. »
— Pierre Lévy, philosophe et pionnier du concept (1994)
Cela signifie que l’intelligence n’est pas uniquement dans les individus, ni dans les institutions, mais dans les interactions, les régulations, les écoutes croisées. C’est une dynamique vivante qui émerge à certaines conditions, et qui produit une valeur collective plus forte que la somme des expertises individuelles.
L’étude de référence menée par le MIT Center for Collective Intelligence (Woolley et al., 2010) a bouleversé les représentations classiques. Elle montre que la performance d’un groupe dépend moins du QI moyen de ses membres que de trois facteurs :
- La capacité à écouter les autres,
- L’équité dans la prise de parole,
- La diversité des profils cognitifs, sociaux et émotionnels.
Autrement dit, un groupe “moyen” qui collabore bien produit de meilleures décisions qu’un groupe de “génies” mal coordonné·es.
Une autre étude du CNRS (Mitra et al., 2018) confirme que la qualité de la coopération est un facteur déterminant dans la réussite de projets multi-acteurs, en particulier dans des contextes incertains.
Un levier pour réussir les projets multi-acteurs et complexes
Les projets impliquant plusieurs acteurs (scientifiques, élu·es, entreprises, citoyen·nes, associations, agents publics…) sont de plus en plus fréquents : démarches participatives, plans de gestion, expérimentations locales, projets éducatifs, pactes climatiques, etc.
Dans ces contextes :
- Les savoirs sont fragmentés ;
- Les enjeux sont transversaux ;
- Les intérêts sont parfois divergents.
Mobiliser l’intelligence collective permet de :
- Croiser des points de vue complémentaires,
- Faire émerger des consensus opérants,
- Renforcer la légitimité et la mise en œuvre des décisions,
- Créer de la confiance et de l’engagement dans la durée.
Environnement & biodiversité
Lors de l’élaboration du plan de gestion concertée de la forêt de Mare Longue à La Réunion, un dispositif d’ateliers multi-acteurs (habitants, chercheurs, techniciens, collectivités) a permis de faire émerger des priorités communes malgré des usages divergents du territoire.
Résultat : un plan d’action co-construit, mieux accepté, et plus réaliste à mettre en œuvre.
Éducation et jeunesse
Dans le cadre du projet “École du Bonheur” à Saint-Denis, des enfants de CE2 à CM2 ont participé à des ateliers où ils ont formulé eux-mêmes des propositions pour améliorer leur quotidien à l’école.
Le processus, basé sur la coopération et la reformulation, a révélé des besoins souvent invisibles aux adultes (besoin de calme, de reconnaissance, de jeux collectifs non genrés).
Cohésion sociale et participation citoyenne
Lors du forum de “Révèl out Talent”, organisé par le Département de La Réunion, des jeunes issus de diverses catégories sociales ont été associés à des ateliers collaboratifs avec des institutions pour repenser les politiques jeunesse.
La dynamique de groupe, fondée sur la reconnaissance et la co-construction, a permis d’identifier des leviers concrets (lieux-refuges, mentorat, repérage mobile…).
Organisation et gouvernance partagée
Plusieurs entreprises (ex. MAIF, Enercoop) ont expérimenté la co-construction de leur stratégie ou leur raison d’être via des processus d’intelligence collective impliquant salariés, sociétaires, partenaires externes.
Résultat : vision partagée + engagement fort + innovations organisationnelles (coopératives, collectifs autonomes…).
Ce que permet (et ce que ne permet pas) l’intelligence collective
| ❌ Sans intelligence collective | ✅ Avec intelligence collective |
| Savoirs cloisonnés, chacun dans son rôle | Savoirs croisés, approche systémique |
| Décisions imposées ou hors-sol | Décisions partagées, ancrées, réalistes |
| Résistances fortes, appropriation faible | Appropriation progressive, responsabilisation |
| Dialogue figé, désaccords évités | Écoute active, désaccords régulés |
| Fatigue de concertation, manque de sens | Motivation, plaisir de faire ensemble |
L’intelligence collective ne se décrète pas. Elle repose sur des conditions précises :
- Un cadre de confiance où chacun·e peut s’exprimer,
- Une diversité assumée : statuts, savoirs, vécus,
- Une animation structurée mais souple,
- Des outils adaptés : carte d’acteurs, météo collective, vote à points, etc.
- Une posture de facilitateur·rice : écoute, régulation, neutralité, relance.
Ce sont ces dimensions que nous approfondirons dans les prochains articles.
À retenir
- L’intelligence collective est une compétence collective, pas une simple méthode.
- Elle s’applique à tous les domaines où l’on cherche à agir à plusieurs face à des enjeux complexes.
- Elle permet de penser ensemble, décider ensemble et agir ensemble, en mobilisant les ressources de chacun·e.
- C’est un levier de cohérence, de justesse et de confiance, indispensable dans les projets multi-acteurs.
Références :
- Jean-François Noubel, Intelligence collective, La révolution invisible
- Jean-Michel Cornu, La coopération, nouvelles approches (2017)
- Frédéric Laloux, Reinventing Organizations (2014)
- Le modèle de l’échelle de participation (Sherry Arnstein, 1969)